Nichole Ouellette
 présente
présente
Observations, notes et recherches
Antée
Audience
Ballast et remblais
Bibliographie
Conseil d'administration
Calendrier 2001 - 2002
Écorce de bouleau, canot
Écorce de bouleau, canot
Écorce de bouleau, usage
Frère Alexandre Blouin
Gauvreau, Marcelle
Gauvreau, chronologie
Gauvreau, études
Gauvreau, carrière
Gauvreau, lectorat
Herbier Louis-Marie
Herborisation, plante rare
Herborisation, Laurentides
Herborisation, tourbière
Identification de plantes
Intelligence de l'homme
Inventaire d'un habitat
Montage en herbier
Kalm Pehr en Améique
Kalm, en Nouvelle-France
Kalm Pehr, scientifique
Marie-Victorin, biographie
Marie-Victorin, la botanique
Marie-Victorin, l'arbre
Marie-Victorin, le Québécois
Marie-Victorin, les enfants
Marie-Victorin, l'humour
Mère sauvage, fille cultivée
Partenaires
Provancher, Léon
Rhus radicans - toxicité
Rhus radicans - solutions
Sécher des plantes
Termes et conditions
L'arbre

Art de vivre au Québec
Conte
L'arbre qui se détache

Papier peint
Feuilles d'automne

Regards des petites personnes
Arbres d'automne

Navigation
Accueil
Par Marie-Victorin
Édition numérique
Divisions de l'ouvrage
DICOTYLES
MONOCOTYLES
Plantes comestibles
Plantes introduites
Plantes médicinales
Plantes rares
Faire un don
À La UNE
PHOTOGRAPHIES
|
Informations cueillies sur le terrain, photos, dates,
coordonnées géographiques (GPS), édition Internet
Frère Marie-Victorin (1885-1944)
Grand Québécois

Photo publiée dans le quotidien La Presse, le 30 septembre 1944. |
Grand Québécois, maître à penser, point de référence pour tout un peuple, directeur-fondateur de l'Institut botanique de l'Université de
Montréal, auteur de la Flore laurentienne.
|
L'année 1994 marque le 50e anniversaire de la mort du frère
Marie-Victorin. Chaque semaine, la publication d'extraits de la Flore laurentienne,
dans les quotidiens : La Presse et
Le Nouvelliste, maintient son héritage
vivant. Le génie du frère tient à sa vision d'avant-garde et à
son intelligence des composantes de la planète. De ses dons de communicateur, il suscite
l'intérêt et avive la curiosité sur le monde qui nous
entoure. Publiée en 1935, la Flore laurentienne demeure un
chef-d'œuvre de nos patrimoines scientifique et littéraire. L'ouvrage sert encore aujourd'hui à l'enseignement de la botanique à
l'université. L'écriture sensible, claire, précise, transparente et accessible
nous ancre dans le réel où nous naissons, vivons et mourrons.
 |
Frère Marie-Victorin à Cuba
janvier 1939.
|
Parfois l'auteur laisse libre cours à son émotion dans sesdescriptions. Du
calypso bulbeux (p. 832), il écrit :
«
Par l'extraordinaire délicatesse de l'ensemble, par
l'équilibre de tant de couleurs diverses, par la multiplicité des détails et
l'originalité de la forme, cette fleur est un chef-d'œuvre de beauté, une création sans analogue dans le monde des fleurs, si riche
pourtant. »
Ailleurs l'humour transpire devant des croyances populaires étonnantes. Le texte sur
l'Acorus roseau (p. 845) illustre un sourire en coin. « En Europe, au moyen-âge, on se
servait des rhizomes de l'acorus comme litière odorante sur le plancher des
cathédrales. En Chine, une superstition veut que la plante chasse les
démons. En Indes, le sucre combat les coliques des enfants. Dans le district
de Montmagny, les rhizomes font passer les grandes fièvres ». Exemples parmi des
milliers.
Une plante à la main, le manuel sous les yeux, on prend conscience de la somme phénoménale
d'informations contenues dans la Flore laurentienne. Une
initiation d'où
se dégage la personnalité de l'homme de sciences par ses travaux d'observations, ses recherches,
ses réflexions, sa lucidité, sa précision, sa force de caractère, son
érudition, son génie. Le frère Marie-Victorin transmet ses connaissances et sa compréhension des lois de la
nature. Sur le terrain, il invite à refaire les découvertes, à vérifier ses dires,
à pousser la curiosité au-delà des apparences.
La Flore laurentienne garde mémoire des relations intimes entre les premières nations, le peuple
du Québec et leur terre natale
- Fonds d'archives Mère-Marie-des-Anges (1883-1967),
sœur aînée du frère Marie-Victorin
-
Fonds d'archives
de la société canadienne d'histoire naturelle (1923-1972)
- Fonds d'archives
de la Société de biologie de Montréal
(1922- )

51º 37' 46.23" N - 75º 12' 31.94" O,
Baie-James (Municipalité), 110 miles à 3000 pieds d'altitude, entre le 50° 25' 09.5" N - 073° 52' 21.4" O et le 51° 55' 10" N - 074° 05' 18" O, soit entre
Mistissini (Village cri) et l'île Le Veneur, dans le cours moyen de la
rivière Eastmain.
Lac Mistassini, archipel Kasapominskat, île Marie-Victorin, 10:24 le vendredi 22 juillet 2005, photo Lac_Mistassini_040_800.
|
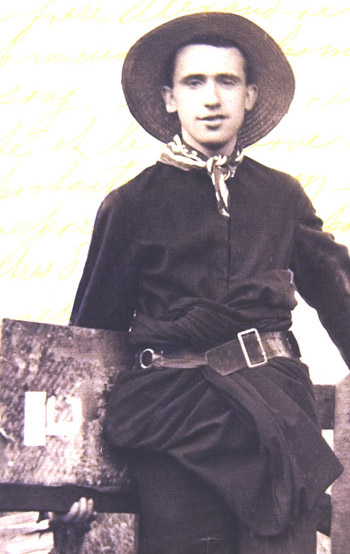
MON MIROIR journaux intimes (1903-1920) du frère
MARIE-VICTORIN. Texte intégral, édition établie et annotée par Gilles Beaudet,é.c. et
Lucie Jasmin, 816 pages. Dépôt légal 3e trimestre 2004, Bibliothèque nationale
du Québec, © Éditions
Fides 2004. |
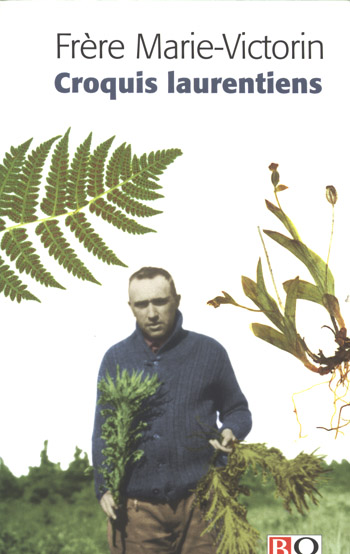
Croquis laurentiens
du frère MARIE-VICTORIN, 249 pages.
Couverture : le frère Marie-Victorin herborise en Minganie, le 3 août 1928.
Édition originale ; Montréal : Frères des écoles chrétiennes, 1920. Dépôt
légal 1er trimestre 2002, Bibliothèque nationale du Québec.
© Éditions
Fides, 1982. © Bibliothèque
québécoise, 2002, pour la présente édition.
|
Île Marie-Victorin
 |
Détail d'une
carte de la Sûreté du Québec : Baie-James, lac Mistassini, îles Montpetit,
Mintunikus Misaupinanuch, Manitoumouc, André-Michaux, Marie-Victorin, Dablon,
Macoun.
|
|
[ Antée ] [ Audience ] [ Ballast et remblais ] [ Bibliographie ] [ Conseil d'administration ] [ Calendrier 2001 - 2002 ] [ Écorce de bouleau, canot ] [ Écorce de bouleau, canot ] [ Écorce de bouleau, usage ] [ Frère Alexandre Blouin ] [ Gauvreau, Marcelle ] [ Gauvreau, chronologie ] [ Gauvreau, études ] [ Gauvreau, carrière ] [ Gauvreau, lectorat ] [ Herbier Louis-Marie ] [ Herborisation, plante rare ] [ Herborisation, Laurentides ] [ Herborisation, tourbière ] [ Identification de plantes ] [ Intelligence de l'homme ] [ Inventaire d'un habitat ] [ Montage en herbier ] [ Kalm Pehr en Améique ] [ Kalm, en Nouvelle-France ] [ Kalm Pehr, scientifique ] [ Marie-Victorin, biographie ] [ Marie-Victorin, la botanique ] [ Marie-Victorin, l'arbre ] [ Marie-Victorin, le Québécois ] [ Marie-Victorin, les enfants ] [ Marie-Victorin, l'humour ] [ Mère sauvage, fille cultivée ] [ Partenaires ] [ Provancher, Léon ] [ Rhus radicans - toxicité ] [ Rhus radicans - solutions ] [ Sécher des plantes ] [ Termes et conditions ]
[ Préface ] [ Abrégé historique ] [ Esquisse générale ] [ Synopsis des groupes ] [ Clef artificielle ] [ Glossaire ] [ Citation d'auteurs ] [ Cartes et tableaux ] [ Observations, notes ]
|

 le samedi 28 juin 1997 - le samedi 12 mars 2000 le samedi 28 juin 1997 - le samedi 12 mars 2000
le dimanche 1er juillet 2012 - le 10 septembre 2013
constante mouvance de mes paysages intérieurs
|